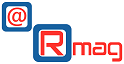Sa descente aux enfers a duré plus de trois ans. Trois années pendant lesquelles Clotilde, 43 ans aujourd’hui, a souffert d’une maladie étrange et incompréhensible. Du moins au début. “C’était en 2017. Je venais d’accoucher d’une petite fille. J’étais une jeune maman heureuse. Après six mois de congé, j’ai repris mon travail de manager en fonction logistique. Et puis tout a basculé.” Les premiers symptômes apparaissent sans prévenir, en voiture, alors qu’elle se rend à Bruxelles. Une étrange sensation physique l’envahit : l’impression d’être vidée de son sang et ne plus rien ressentir. “Comme si j’étais spectatrice de tout”, précise-t-elle. Les symptômes disparaissent au bout d’une heure. Mais ils reviennent au cours des semaines et mois suivants et durent chaque fois plus longtemps : deux heures, puis trois, quatre, et sont de plus en plus désagréables. Clotilde ne ressent plus la fatigue, devient insomniaque, s’évanouit parfois, souffre de vertiges et de spasmes : “Comme quand vous avez la paupière qui tremble à cause de la fatigue, mais à l’estomac… Ça me faisait parfois vomir.” Elle a l’impression de “perdre les pédales”.
Les médecins diagnostiquent “une dépression très profonde” et prescrivent des antidépresseurs. Mais son état se dégrade encore. Des douleurs aux bras et aux jambes, comme des brûlures, apparaissent, ainsi que des migraines. Elle pleure, non pas parce qu’elle se sent triste – elle assure ne plus ressentir ni sentiment ni émotion -, mais parce que “les larmes coulent toutes seules”. Elle se met à fumer “comme une dingue”, confie-t-elle, alors qu’elle n’avait jamais allumé une cigarette. Des hallucinations apparaissent : “Parfois, je voyais ma main gonfler”, se souvient-elle. Quatre mois après les premiers symptômes, des idées suicidaires se manifestent. Les médecins ajoutent alors des anxiolytiques et des antipsychotiques. Clotilde est admise à l’hôpital psychiatrique. Deux fois. Rien n’y fait. Plus d’un an après son escapade belge, personne ne semble comprendre ce qu’il lui arrive.
Les prémices de sa guérison viennent de recherches sur Internet qui la conduisent à lire la littérature scientifique. La jeune maman envoie alors des e-mails à de nombreux chercheurs, dont le Pr Marion Leboyer, psychiatre aux hôpitaux universitaires Henri-Mondor (AP-HP, Créteil) et directrice de la Fondation FondaMental, qu’elle rencontre mi-2019. Pour expliquer les troubles psychotiques de Clotilde, la chercheuse avance l’hypothèse d’une inflammation de son organisme et une réaction auto-immune. Une prise en charge en neurologie à Lyon permet de confirmer une inflammation, mais pas de déterminer son origine. Les traitements proposés échouent. En juin 2020, les perspectives de guérison s’éloignent.
La suite relève presque du hasard. Une ostéopathe lui recommande d’aller voir un médecin du service de médecine interne du Centre hospitalier de Lens. L’homme se passionne pour le cas Clotilde. Il l’appelle toutes les semaines et lui fait passer une série d’examens. Au bout de deux mois, il décide de lui prescrire de fortes doses de corticoïdes. Le traitement commence en décembre 2020 et les premiers signes d’amélioration se manifestent déjà en janvier. En mars, Clotilde a récupéré “à 70 %”. Le médecin met alors en place un traitement immunosuppresseur, qui limite l’action du système immunitaire. Un an plus tard, après avoir modifié et réévalué les doses, elle est guérie et a retrouvé sa vie d’avant.
Psychose auto-immune, quand le système immunitaire détraque le cerveau
Que lui est-il arrivé ? D’abord, Clotilde a toujours été sujette aux maladies auto-immunes, qui se manifestent par un dysfonctionnement du système immunitaire qui “met le feu” à l’organisme et produit des anticorps qui se retournent contre les cellules de l’organisme (autoanticorps). En cas d’infection, la réaction normale du corps humain est de provoquer une inflammation afin de se défendre contre cette attaque extérieure. Mais si cette réponse persiste à bas niveau de façon chronique, cela peut provoquer des maladies auto-immunes, voire des maladies mentales. C’est le cas de Clotilde, qui a été victime d’une… “psychose auto-immune”. La cause reste inconnue, mais elle pourrait être liée aux changements hormonaux qui se sont déroulés pendant et après sa grossesse. Lors de ses premières règles, Clotilde avait d’ailleurs subi une dérégulation auto-immune de la thyroïde.
La découverte d’autoanticorps dirigés contre des récepteurs cérébraux chez des patients psychotiques remonte à 2017, grâce à des équipes américaines et françaises, dont celles du neurobiologiste Laurent Groc (CNRS). Depuis, plusieurs autoanticorps responsables de psychose auto-immune ont été identifiés. Et notamment dans une étude publiée en mars dernier dans la revue Translational Psychiatry et cosignée par Uwe Maskos, chercheur en neurobiologie (Institut Pasteur, CNRS) et Marion Leboyer. Leurs travaux démontrent chez certains patients schizophrènes un lien entre leur maladie et la présence dans leur sang d’un autoanticorps qui attaque les récepteurs nicotiniques des macrophages (des globules blancs). Ces derniers sont impliqués dans la production de cytokines – les fameuses protéines popularisées lors de la pandémie de Covid-19 -, qui luttent contre les infections grâce à leur action inflammatoire. Mais lorsque ces macrophages sont perturbés, leur production de cytokines se dérègle. Les chercheurs ont pu montrer que ces autoanticorps provoquent une inflammation du corps, qui engendre ensuite les symptômes de la schizophrénie des patients. Lorsqu’on évoque avec lui le cas de Clotilde, Uwe Maskos confirme qu’il “colle parfaitement” avec les hypothèses actuelles concernant les psychoses auto-immunes. Et la jeune femme est loin d’être la seule concernée.
Chez les souris, une simple grippe peut provoquer une psychose
Ce sont 20 % des patients atteints de troubles psychotiques ou de troubles bipolaires qui souffriraient en réalité d’une psychose auto-immune. Les chercheurs ne parviennent pas encore à identifier les mécanismes responsables de la production des autoanticorps, mais des études sur des souris suggèrent qu’ils pourraient se déclencher après des infections virales ou bactériennes bronchiques, comme le virus de la grippe ! Plus généralement, les dysfonctionnements immunitaires concernent entre 30 et 40 % des patients atteints de maladies mentales”, d’après les travaux de la Fondation FondaMental. “Avec, à chaque fois, des inflammations de bas niveau qui persistent dans le temps et qui sont déclenchées par divers facteurs environnementaux (infections, stress sévère, pollution) et leur interaction avec des facteurs génétiques”, indique Marion Leboyer. Des variants génétiques responsables de défenses insuffisantes face à certains virus ou certaines bactéries permettent par exemple à ces infections de persister dans le sang, provoquant une inflammation puis des réactions auto-immunes. Ce qui peut entraîner des troubles psychotiques.
L’enjeu des recherches est donc de repérer les biomarqueurs comme les autoanticorps – par exemple grâce à des prélèvements sanguins -, puis de trouver une solution adaptée à chaque patient. “Il n’y a pas eu d’énormes progrès dans les traitements des maladies mentales depuis des décennies, il faut trouver de nouvelles pistes, et l’étude du système immunitaire peut nous aider”, plaide Uwe Maskos. Le scientifique souhaite que des essais cliniques sur l’humain soient rapidement lancés dans le but de tester des traitements qui stimuleraient les récepteurs nicotiniques afin de freiner la production de cytokines inflammatoires. Chez l’animal, l’administration de fortes doses de nicotine produit des effets anti-inflammatoires.
Mais hors de question, évidemment, de faire fumer les patients schizophrènes, qui sont déjà 80 % à être de gros consommateurs de cigarettes. “L’idéal serait de développer un traitement qui produirait un meilleur effet que la nicotine, mais sans son effet addictif”, poursuit-il. Cette piste est d’ailleurs explorée à l’Institut Pasteur. Le CNRS, l’université de Bordeaux, le Mircem (centre national de référence des maladies inflammatoires rares du cerveau et de la moelle), neuf centres hospitaliers et la Fondation FondaMental ont également lancé le programme TiM-DePist, un projet qui vise à tester le médicament Rituximab, un immunosuppresseur, en association au traitement habituel chez les personnes touchées par des psychoses auto-immunes.
Une révolution en cours
Etats-Unis, Allemagne, Royaume-Uni… De nombreux projets de ce type se lancent partout où les chercheurs ont détecté des liens entre inflammation et troubles psychiatriques. Belinda Lennox, directrice du service de psychiatrie de l’Université d’Oxford, a par exemple prélevé des échantillons sanguins de milliers de personnes atteintes de psychoses. Ses travaux montrent qu’environ 6 % des patients ont un taux supérieur d’un autoanticorps qui cible les récepteurs “NMDA”, essentiels pour la mémoire et la plasticité des synapses. La chercheuse ne sait pas pourquoi ces autoanticorps sont produits par l’organisme, même si elle possède des pistes : tumeurs bénines, virus de l’herpès ou gènes défaillants. “Mais il est possible que ces autoanticorps puissent atteindre l’hippocampe, ce qui expliquerait les pertes de mémoire, les délires et les hallucinations dont souffrent certains patients”, avance-t-elle. La chercheuse a lancé un essai clinique visant à trouver un traitement basé sur des immunothérapies qui devrait se terminer fin 2025. D’autres scientifiques tentent également de mieux comprendre les liens entre les micro-organismes de l’intestin – le microbiote – et la dépression. La fondation FondaMental a lancé un projet qui doit tester l’effet d’un complément alimentaire. Et à l’Université de Stanford, aux Etats-Unis, des patients atteints de diverses pathologies doivent suivre un traitement qui implique de suivre un régime cétogène, dans lequel l’apport en glucides est limité.
Une véritable révolution est donc en cours au sein du monde de la psychiatrie, qui s’oriente désormais vers la découverte des causes sous-jacentes des maladies plutôt que la description et classification des symptômes. “Les maladies mentales sont aujourd’hui définies par des manuels de diagnostics internationaux [NDLR : comme le DSM]. Grâce à eux, nous parlons la même langue à Tokyo, Paris et New-York, résume Marion Leboyer. Mais cette catégorisation a abouti à identifier une large variété de profils cliniques pour une même maladie. Or ces différents profils n’ont jamais été validés sur le plan biologique : c’est-à-dire que ces différentes maladies mentales n’ont pas été associées avec précisions à des marqueurs objectifs mesurables dans le sang, par l’imagerie cérébrale ou par des marqueurs digitaux.” Or les recherches actuelles montrent que des troubles mentaux peuvent avoir des racines biologiques qui doivent être traitées comme des maladies “classiques”.
Autre problématique liée à ces classifications internationales : certains essais cliniques visant à tester des médicaments ont échoué car ils regroupaient des patients qui semblaient partager des symptômes communs, mais dont les maladies n’étaient probablement pas liées aux mêmes mécanismes. Les manuels de diagnostics ont d’ailleurs évolué et parlent désormais de “troubles bipolaires”, de “spectres schizophréniques”, et évoqueront sans doute bientôt des “dépressions inflammatoires”, “immunologiques” ou “de stress”.
“Cette révolution va vers l’union du corps et de l’esprit en affirmant que les facultés et maladies mentales ne dépendent pas seulement de la boîte crânienne, qu’on a longtemps crue étanche alors que les échanges entre les systèmes nerveux et immunitaire sont très importants”, confirme Pierre-Marie Lledo, directeur du département de neurosciences de l’Institut Pasteur et directeur de recherche au CNRS. L’idée de cette profonde mutation est d’arriver à soigner les maladies psychiatriques comme les autres. “Pendant des années, face à une dépression, les médecins disaient aux patients “vous broyez du noir”, alors qu’il s’agit d’un symptôme qui peut être lié à plusieurs mécaniques, de la même manière que la fièvre peut être le témoin d’une infection bactérienne ou d’un virus, qui nécessitent des réponses différentes”, poursuit le chercheur. Cette tendance vise, aussi, à remettre la biologie au centre du diagnostic de la santé mentale, mais également à unifier la neurologie, la médecine interne et la psychiatrie, en faisant sauter les cloisons construites à la fin du XIXe siècle entre ces différentes spécialités.
Obtenir de meilleures connaissances des mécanismes à l’œuvre dans ces maladies aura de profondes conséquences pour les millions de personnes souffrant de maladies mentales et qui ne répondent pas aux traitements existants. Elles pourraient également donner de nouveaux espoirs à de nombreux malades, mais aussi permettre leur déstigmatisation. L’enjeu est de taille. Près de trois millions de patients souffrent de dépressions en France. Les deux tiers n’obtiennent pas de résultats avec leur premier traitement et 20 à 30 % d’entre eux résistent à l’ensemble des stratégies thérapeutiques. 90 % des malades atteints de troubles bipolaires (entre 650 000 et 1,6 million de personnes) souffrent de symptômes récurrents toute leur vie. Et seules 50 % des 600 000 personnes atteintes de schizophrénies obtiennent une rémission partielle. Malheureusement, la recherche académique en psychiatrie ne reçoit que 2 à 4 % du budget total de la recherche hexagonale. Avec 160 milliards d’euros en coûts directs et indirects, les maladies mentales sont pourtant la première cause des dépenses de santé en France.