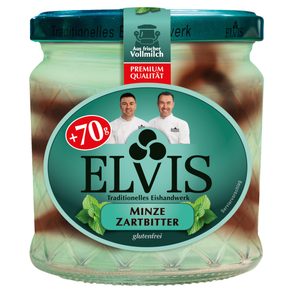Près de 9 000 euros jetés à la poubelle. Le 11 février dernier, à la sortie d’un vol EasyJet reliant Nantes et Toulouse, Julie Marchand retrouve son fauteuil de sport totalement hors d’usage. La joueuse de basket fauteuil, qui évolue en équipe de France depuis deux ans, apprendra plus tard que l’équipement a été coincé sous la remorque des bagages à l’arrivée de l’avion, et traîné sur le tarmac de l’aéroport sur plusieurs dizaines de mètres. Alors que la jeune femme s’apprête à participer à un stage de préparation au tournoi de qualification paralympique, c’est la douche froide : elle constate un métal tordu et limé, des sangles de sécurité brûlées, des roues déviant de leur axe. “J’avais reçu le fauteuil un mois auparavant, il était flambant neuf. Je n’avais même pas fini de le payer !” confie-t-elle à L’Express.
Dans un premier temps, la compagnie aérienne lui propose un remboursement de 1 600 euros – soit moins de 20 % du prix total du fauteuil. Dépitée, Julie Marchand décide d’alerter les médias, participe à plusieurs interviews, évoque les coûts importants des équipements paralympiques… Et reçoit finalement des excuses publiques d’EasyJet, assorties d’un remboursement total de son fauteuil. “Mais pendant plusieurs semaines, j’ai dû jouer avec mon ancien équipement. Ça a eu un impact énorme sur mes performances, ma préparation physique et ma charge mentale”, regrette la joueuse, dont l’équipe ne s’est finalement pas qualifiée lors du tournoi de repêchage féminin pour les Jeux paralympiques 2024, organisé à Osaka en avril dernier.
Cette mésaventure aura néanmoins permis à la basketteuse de mettre en lumière le coût des équipements nécessaires à la pratique du handisport, et les difficultés de certains joueurs à financer ce matériel. “Malgré les différentes aides publiques, le reste à charge est souvent important pour les athlètes. Après l’intervention de ma mutuelle et de la Sécurité sociale, il me restait par exemple 5 000 euros à trouver pour mon dernier fauteuil”, explique-t-elle. Cette somme a été comblée par la participation de plusieurs organismes publics et privés, dont l’association Team 303 – créée en 2011 pour apporter une aide financière et matérielle aux sportifs paralympiques des Pays de la Loire – et les économies personnelles de la basketteuse, qui assure avoir financé un reste à charge d’environ “3 000 euros”. “Et encore, j’ai la chance d’être dans un département aidant, les Pays de la Loire, et d’avoir été accompagnée par plusieurs organismes en cette année de JO… Ce qui n’est pas le cas tous les ans, et surtout pas le cas pour tout le monde”, conclut-elle.
“Il faut savoir se vendre”
Sami El Gueddari, chargé de la performance et de la stratégie paralympique au sein de la Fédération française de handisport (FFH), admet que les dispositifs de financement des équipements “sont très variables” en fonction des disciplines pratiquées, du profil des joueurs, des fédérations et des territoires dont ils sont issus. “Vous avez d’abord une disparité au niveau des aides départementales et régionales, qui ne sont pas les mêmes partout. Le financement des Maisons départementales pour les personnes handicapées (MDPH), par exemple, dépend de la densité du territoire et du volume d’accompagnement, et peut bouger d’une année sur l’autre”, souligne-t-il. Le niveau des athlètes entre également en compte : les sportifs ayant obtenu une médaille mondiale ou olympique sur les deux dernières années, et identifiés comme faisant partie du cercle “haute performance” défini par l’Agence nationale du sport (ANS), seront ainsi prioritaires sur l’ensemble des dispositifs financiers mis en place par l’organisme. Ils bénéficient par exemple d’un revenu annuel garanti de 40 000 euros minimum, et seront plus largement accompagnés dans l’achat de leur matériel sportif. “Il faut d’ailleurs souligner un réel changement de paradigme à l’approche des JO 2024 : le budget alloué par l’ANS sur le sujet a été considérablement renforcé pour les athlètes les plus prometteurs”, tient à préciser Sami El Gueddari.
“Fin 2023, notre budget spécifiquement dédié à l’équipement du handisport s’élevait à 750 000 euros, contre environ 450 000 euros en 2021”, développe Arnaud Litou, manager de la performance paralympique au sein du pôle haute performance de l’ANS. “Cela ne permet évidemment pas d’aider tous les athlètes, ni de financer chaque équipement à 100 %. Mais ce budget permet de compléter les leviers financiers déjà débloqués par les fédérations et les sportifs eux-mêmes”, fait-il valoir. Pour les athlètes les moins accompagnés par l’ANS ou les collectivités, une compétence fondamentale entre alors en jeu. “Il faut savoir se vendre”, résume Sébastien Edelin, chargé de la coordination de projet et du financement au sein du Comité régional handisport Pays de la Loire. “Si le sportif est débrouillard, présente son projet à diverses entreprises et fondations, demande de l’aide, vend son image et son histoire, il peut très bien s’en sortir”, explique ce professionnel, qui a vu de nombreux athlètes créer des cagnottes en ligne, monter des rencontres avec des journalistes locaux et des sponsors du cru, ou encore contacter directement des associations spécialisées.
“Chacun fait comme il peut”
“Dès qu’on change de fauteuil, il faut trouver de nouveaux sponsors… Sinon, on se retrouve tous dans le même cas, à devoir financer de notre poche des milliers d’euros”, témoigne Louis Hardouin, qualifié pour les Jeux paralympiques 2024 en basket fauteuil avec l’équipe de France masculine. Pour financer son équipement, qui vaut “le prix d’une voiture, entre 8 000 et 12 000 euros”, le jeune homme compte pour le moment sur un partenariat avec une marque de fauteuil qui “lui fait des prix”. Pour le reste, le sportif participe régulièrement à des événements afin de rencontrer de nouveaux sponsors, de convaincre des entreprises privées potentiellement intéressées par un investissement dans le handisport, publie sur les réseaux sociaux, n’hésite pas à participer à des émissions télé, et cherche depuis quelques mois un agent. “C’est un peu la débrouillardise, chacun fait comme il peut. Mais c’est vrai que ceux qui sont à Paris auront plus d’opportunités que ceux qui vivent au fin fond d’un département un peu perdu, et ceux qui ont le contact facile seront aussi mieux lotis”, regrette-t-il. Malgré ses efforts et ses compétences, l’addition reste salée pour le futur joueur olympique : la part de financement personnel de son dernier fauteuil s’est élevée à plus “de 4 000 euros”.
Même bilan du côté de Jordan Ducret, joueur de rugby fauteuil en équipe de France depuis 2017. En 2019, lors de l’achat de son dernier équipement – pour la modique somme de 12 000 euros – le double champion d’Europe a pu compter sur les aides allouées par Nantes métropole, le département de Loire-Atlantique et la région Pays de la Loire, ainsi que sur l’accompagnement précieux de la Team 303. Mais l’investissement de ses roues, à hauteur de 2 500 euros, n’a, lui, pas pu être pris en charge : le jeune homme les a financées sur ses fonds propres. “Avec les gars de l’équipe de France, c’est un sujet qui revient souvent : comment financer notre équipement, réunir des sponsors, trouver les bonnes astuces… C’est délicat, surtout quand on cherche un sponsor individuel alors qu’on joue dans un sport collectif”, témoigne-t-il. D’autant que le rugbyman, peu à l’aise avec les réseaux sociaux, ne se considère “pas très bon” pour “percer” sur Internet. En attendant, il continue d’accepter chaque invitation de la Fédération de rugby pour intervenir lors de tables rondes et rencontrer d’éventuels partenaires, répond aux interviews, chasse la moindre occasion de développer sa visibilité. “Le plus dur, c’est de trouver le premier sponsor… Après, ça avance un peu plus vite. Il ne faut rien lâcher, on n’a pas le choix. Sans aides financières, beaucoup d’entre nous ne pourraient pas pratiquer ce sport”, confie-t-il.
Jean-Baptiste Alaize, quadruple champion du monde et recordman du saut en longueur des moins de 23 ans, qui a représenté la France aux Jeux paralympiques de Rio en 2016, garde un souvenir amer de cette “quête” aux financements. “Une prothèse de saut, ça peut monter jusqu’à 30 000 euros. J’ai enchaîné les interviews et les plateaux télé pour trouver des sponsors, j’ai beaucoup communiqué, mais malgré ça, j’ai eu beaucoup de mal à trouver des financements. En France, le handisport reste malheureusement un luxe”, regrette-t-il. A tel point qu’en 2021, l’athlète lance une cagnotte en ligne pour regrouper les fonds nécessaires au financement de ses prothèses, avant de tenter de se qualifier pour les JO de Tokyo – pour lesquels il ne sera finalement pas sélectionné. “C’est une charge mentale avant la préparation, du temps passé, et la sensation qu’on n’est pas vraiment reconnus à notre juste valeur”, estime-t-il trois ans plus tard, alors qu’il s’apprête à concourir aux JO de Paris pour le Burundi, son pays natal. “Là encore, les cas de figure sont très variables : beaucoup de centres d’appareillages prennent les sportifs comme égérie, et leur offrent à ce titre le matériel. D’autres bénéficient d’une aide de l’ANS. Mais il arrive que certains doivent également payer tout ou partie de cet équipement”, commente Sami El Gueddari.
Mathieu Bosredon, champion d’Europe et vice-champion du monde de paracylisme, admet que les nouvelles technologies “ont fait exploser le prix des équipements” de certains sports, notamment dans sa discipline, et que le sponsoring est “un vrai sujet dans le handisport”. “Mais il est aussi bien plus simple qu’avant de trouver des partenaires, avec des aides financières qui auraient été inimaginables il y a encore dix ans. Il y a une vraie prise de conscience sur le sujet”, nuance-t-il. Depuis les Jeux de Rio, en 2016, l’homme a ainsi vu les propositions de contrat se faciliter et se multiplier dans sa discipline : “Avant, il fallait vraiment aller chercher les sociétés, expliquer notre projet, les bénéfices d’un éventuel partenariat… Aujourd’hui, les offres sont bien plus régulières, et encore plus avec les JO de Paris.” Tout l’enjeu reste, selon l’athlète, de pérenniser cet intérêt du monde privé et des institutions publiques : “Ce serait dommage que cet engagement des grandes entreprises et de l’Etat retombe comme un soufflé après les Jeux de Paris”, prévient-il.