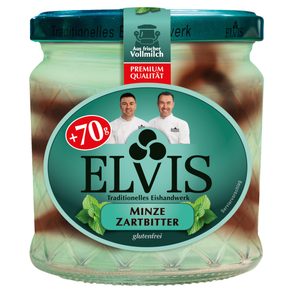Jamais autant de bulletins ne vont s’amonceler sur les bureaux de vote. Les Français pourront choisir entre 37 listes distinctes lors des dixièmes élections européennes qui se dérouleront du 6 au 9 juin 2024. Au-delà des partis traditionnels, plusieurs listes anticapitalistes et révolutionnaires, de nombreuses listes écologistes et décroissantes, un parti pirate ou encore une liste pour la libération de la Palestine se battront pour obtenir les sièges d’eurodéputés, et pouvoir participer aux débats et votes qui détermineront l’avenir de l’Europe au Parlement bruxellois durant les cinq prochaines années.
Pourquoi tant de listes ? Une partie de la réponse repose sur des conditions d’éligibilité très flexibles : le critère principal est de réunir 81 personnes, soit le nombre de sièges dont la France dispose au Parlement. Au contraire de l’élection présidentielle, il n’est pas obligatoire de réunir 500 parrainages d’élus locaux issus de 30 départements différents.
Il est d’ailleurs possible pour n’importe quel citoyen français, majeur, jouissant de tous ses droits civils de se présenter sans l’appui d’un parti politique, à condition qu’il ne cumule pas d’autre mandat exécutif, qu’il n’exerce pas les métiers de lobbyiste ni ne soit à la tête d’une société de conseil. En France, le nombre de candidats dépasse ainsi les 3 000 à chaque élection, soit entre deux et trois fois plus que l’Allemagne, la Grèce ou la Pologne.
Le vote des Français fractionné par les nombreuses possibilités
Le nombre très élevé de listes a néanmoins un effet négatif : le fractionnement des votes. De nombreuses “petites” listes, c’est-à-dire qui ne sont pas adossée à une structure politique traditionnellement forte, récoltent un nombre particulièrement maigre de voix. En 2019, par exemple, 12 des 34 listes avaient récolté moins de 10 000 voix, et 26 d’entre elles n’avaient pas dépassé 3 % des suffrages. Or dans la loi française, une liste se doit d’atteindre le seuil électoral de 5 % des votes afin d’obtenir un minimum de quatre sièges pour pouvoir entrer au Parlement européen. En 2019, cela a conduit à ignorer 17 % des voix exprimées, soit 4,5 millions de votes en France.
Face à cet éclatement du suffrage, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) avait même été déposée après le scrutin de 2019 pour abaisser ce seuil des 5 % – qui est par exemple situé à 4 % en Italie ou absent en Allemagne. Celui-ci a finalement été jugé conforme à la Constitution par le législateur, qui l’estime nécessaire pour “contribuer à l’émergence et à la consolidation de groupes politiques européens de dimension significative”, et sera donc maintenu cette année. Il y a ainsi peu de contraintes pour se présenter, mais aussi peu de chances d’obtenir des sièges. Finalement, seules six listes avaient franchi ce seuil lors du dernier scrutin. Pourtant, cette année, les “petites” listes sont encore plus nombreuses.
Une pléthore de petites listes
Dans les bureaux de vote, les Français retrouveront évidemment les listes adossées aux partis français les plus importants. Comme la liste de la majorité présidentielle (qui réunit notamment Renaissance, le Modem, Agir, et Horizon) menée par la présidente du troisième groupe européen “Renew” mais très peu connue en France, Valérie Hayer. Mais aussi celles des Républicains dirigée par François-Xavier Bellamy ; du Parti socialiste Place Publique menée par Raphaël Glucksmann ; de la France Insoumise dont la tête est Manon Aubry ; ou encore des communistes.
En plus de la liste écologiste EELV portée par Marie Toussaint, les Européennes 2024 comptent de très nombreuses listes plaçant l’écologie au centre de leur combat, via des approches différentes : le nucléaire, le renouvelable, la décroissance, le compromis… Pierre Larrouturou, actuellement Eurodéputé sur la liste PS-Place Publique, ambitionne cette année d’être réélu sous une nouvelle liste écologiste. On compte aussi plusieurs listes d’extrême droite : celle du Rassemblement National menée par Jordan Bardella, la liste Reconquête de Marion Maréchal, ou encore la liste Les Patriotes dirigée par l’ancien bras droit de Marine Le Pen, Florian Philippot.
Suivent ensuite une multitude de “petites” listes, créditées pour la plupart à entre 3 % et quelques dixièmes de pourcentage : celle du parti animaliste, la liste Free Palestine, la liste Espéranto langue commune, la liste “des banlieusards” d’Hadama Traoré, celle dédiée à La Défense des enfants, ou du Parti Pirate. Ou encore celle du souverainiste François Asselineau qui prône le Frexit, c’est-à-dire la sortie définitive de la France de l’Europe.